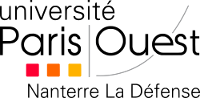Fellini ou l'humanité invincible : récit d'Epave et de Veaux.
Fellini ou l'humanité invincible :
récit d'Epave et de Veaux.
Prenez l'Italie des années 50. Une petite cité balnéaire. Minable à la pleine saison, morne à la morte. Mettez-y une bande de copains désœuvrés, accrochés à ses rues comme les ivrognes aux comptoirs. Faîtes là raconter par Fellini. Vous obtiendrez I Vitelloni, un chef d'œuvre.
Maintenant prenez un escroc vieillissant et ses acolytes, des arnaques sans cesse plus basses et médiocrement lucratives, spoliant les plus pauvres, sans vergogne. Racontez une histoire, confiez là à Fellini. Il Bidone. Chef d'œuvre.
Quelle honte, direz-vous.
Les êtres humains peuvent-ils être bas et beau ? Mauvais et magnifiés? Ne faut-il pas supprimer la sempiternelle et incurable racaille? L'anéantir comme la peste?
Mais de l'idéologie, Fellini se moque. Il parle d'universel, de la fragile psychologie humaine confrontée à l'âpreté de la réalité sociale; et de la révolte, salvatrice devant l'éternel.
Pour autant Fellini n'est pas tendre et béat devant ses personnages, il souligne avec force et férocité leurs travers, leur faiblesse, leur hypocrisie. Mais une férocité douce amère, loin de toute sentence.
Fellini tourne en 1953 I Vitelloni, « les Veaux » en français, mettant en scène une troupe de jeunes gens statiques à qui tout échappe et rien n'arrive. Ces personnages, tous encore ou presque chez leurs parents, se réfugient dans une camaraderie beuglante, pour mieux masquer la vacuité de leur vie. Ces veaux arpentent les rues de la ville, leur théâtre, où se jouent au jour le jour leurs tentatives de distraction.
Beuverie, élection de « miss été », spectacle dérisoire, drague, nouvel an costumé; leur vie n'est rythmée que par un va-et-vient de plaisirs fugaces.
Au milieu de cela, les codes, les mœurs, la culture rurale italienne, l'attachement familial, la forte croyance religieuse, voire la bigoterie, le sens de la réputation et de l'honneur. Autant d'éléments avec lesquels nos personnages composent, plus ou moins heureux.
L'un, coureur de jupon bellâtre et fanfaron, met enceinte une de ses conquêtes et se doit de l'épouser, sans pour autant renoncer aux histoires d'un soir.
L'autre, idolâtrant sa mère, surveillant sa sœur, sans pour autant aider le précaire foyer familial au moyen d'un revenu. Larmoyant dès qu'une difficulté semble mettre en danger son cocon.
Un autre encore, convaincu de son talent d'écrivain, se perd en rêve immobile et en discours, entre exaltation et désespoir.
Le plus jeune, délicat, attentif aux autres, se cherchant encore, tout en observant le triste spectacle de ses ainés et amis. Il finira par partir, au bord de l'étouffement, chercher de quoi remplir sa vie.
Fellini dresse certes un portrait acide de ces jeunes gens, mais souligne avant tout leur humanité, interdisant toute condamnation définitive. Car si l'être humain n'a pas de nature, il peut alors tout recueillir, prendre toute forme, se perdre en tout lieu. Condamner les conséquences de cette réalité, sans comprendre leurs origines mentales et sociales, c'est condamner l'humanité entière.
Une scène. La jeune femme du coureur de jupons, une nouvelle fois trompée, esseulée jusque tard le soir, nourrisson au bras, fuit du foyer conjugal pour se réfugier chez son beau-père. Le mari, accablé et réduit à la torpeur finira par la retrouver, se confrontant au père dans une scène splendide et terrible où le vieux, pris par une honte rageuse, plein de larmes et de colère, défait sa ceinture, prêt à battre le fils. Ce geste, plus symbolique que cruel (le vieux ne peut plus en effet battre son fils), est empreint à l'écran d'une beauté saisissante et fait figure de révolte intime et ultime contre les pratiques du jeune homme. Ce fils, bousculé par tant d'humanité – celle du vieux père meurtri au plus profond, et celle de sa femme éperdument bonne et amoureuse – fut lui même atteint par la conscience de ses actes, et ému, véritablement, du trésor qu'il possède, sa femme, son enfant. En une scène il était redevenu noble.
De noblesse et de perdition aussi il est question dans Il Bidone, réalisé deux ans plus tard en 1955. Il Bidone signifie « arnaque », « arnaqueur », mais aussi « épave ».
Une bande d'escrocs s'évertue à flouer ses concitoyens, les faibles de préférence. Ils mettent ainsi en place des stratagèmes pour spolier les pauvres des bidonvilles, se faisant passer pour les promoteurs des nouvelles constructions en dur promises par l'Etat; inventent des entourloupes chez le pompiste, se faisant avancer l'argent qu'ils ne rendront bien sûr pas. Leur pratique privilégiée reste l'abus de fidèles crédules : des fermiers sans-le-sou qui croyant à la découverte d'une tombe contenant un trésor sur leur terre (en réalité de la ferraille dorée enfouie préalablement par l'équipée diabolique) s'empressent de confier à des religieux (nos imposteurs déguisés, porteurs de la « nouvelle ») l'intégralité de leurs économies. De l'argent frais et liquide, sensé honorer le défunt (les ossements placés eux aussi, dans la tombe) de messes onéreuses. L'arnaque parfaite.
Au fur à mesure du film, le vétéran de la bande, Augusto, s'essoufflera, tiraillé par la vulgarité de certains de ses compagnons et par la redécouverte de sa fille. L'espoir semble alors naitre pour cet homme fatigué : devenir un père, s'occuper de sa fille, lui payer des études, aller au cinéma. Mais la prison, implacable, achèvera de boucher ce nouvel horizon. A sa sortie, ses compagnons partis, et trop honteux pour rejoindre sa fille, Augusto se retrouvera seul, sans autre alternative que de continuer vaille que vaille sa vie d'arnaqueur minable.
Et pourtant, Fellini décidera d'offrir à ce personnage une sortie de toute beauté, un final digne des plus grandes tragédies. Là encore beauté et misère se confondent, boue et or se mélangent dans les cœurs, et l'être-humain, complexe, compose.
Dernière partie du film. Augusto et ses compères renouvelés, roulent poussiéreux vers une arnaque supplémentaire de fermiers, fidèles au Pape et croyant en l'argent. L'ultime coup pour Augusto. C'est du moins ce qu'il avait dû décider en cachant à ses acolytes l'intégralité de l'argent volé, affirmant n'avoir pu le prendre à la famille de paysans. Il est démasqué, battu, et laissé agonisant sur le bord de la route, blessé à la tête et au dos. Il restera échoué dans la caillasse blanche, paralysé comme une épave, qu'il incarne alors, et succombera dans l'âcreté de la poussière. Sans linceul aucun, si ce n'est la magnifique mise-en-scène de Fellini, et son regard, à la fois tendre, amer et cruel.
Car avant de sceller sa chute, le vieil homme achèvera sa déchirure.
La faute à pas de chance. La faute à cette fille de 18 ans, infirme, qui sans l'usage de ses jambes et traînant des béquilles, rayonne de vie et d'enthousiasme. Cette fille qui ne se plaint que d'une chose : être une charge pour son père et sa mère, alors même qu'elle déploie toute son énergie à rendre meilleure la vie de tous. Cette fille qui fait face à Augusto, cette montagne d'hypocrisie prêt à déposséder cette famille si fragile ne tenant qu'à force de courage et de bonté. C'en est trop pour le vieil Augusto. Tant d'humanité lui renvoie le négatif viciée de la sienne.
Alors il se révolte. Contre lui-même. Traversé par la pensée de venir en aide à cette fille, il imagine un instant de lui payer une opération et soudain, il se dégoûte, rejette violemment l'adolescente, et s'en va, lui refusant même une prière. Qu'a-t-il fait ? Il s'est sauvé.
Augusto n'est plus minable. Il est conscient dans sa chair de sa bassesse et il ne se pardonne pas. Il se saoule de son ignominie. Il est grand. Alors oui, il refusera d'aider cette famille. Oui, il leur volera leur argent. Mais il est trop tard pour renoncer à une vie de misère et de médiocrité. Et Augusto se condamne. Comme la lumière brûle les yeux de celui resté dans l'obscurité, il ne se juge pas digne de noblesse. De quel droit pourrait-il passer pour bon devant cette famille-là ? Cette pensée l'écœure, tout autant que lui-même. L'argent qu'il a dérobé lui permettra d'arrêter cette vie pense-t-il, sans pour autant refermer sa fêlure. S'ensuit ce qu'il ne pouvait prévoir : la découverte de la supercherie, son abandon, sa mort.
Augusto a perdu la vie, entre-temps il aura peut-être gagné sa part de noblesse. Et Fellini, sa place au panthéon des grands humanistes. Car aimer l'homme c'est avant tout tenter de le comprendre, et ne jamais faire de son existence une essence indépassable, prête à être jugée et rejetée.
L'être humain, semble nous dire Fellini, fait face à un ensemble de déterminismes : la morale, la tradition, les conditions matérielles de vie, le hasard et tant d'autres. Ces facteurs le propulsent en une situation donnée où souvent il se perd et s'oublie. Jusqu'au jour où il se révolte, révélant un noyau pur d'humanité.
Pour Fellini, un monde où l'Homme n'est pas condamnable est un monde où l'homme se révolte. Contre la société et ce qu'elle engendre en lui-même. Un monde rempli d'espoir en somme.
Simon Ribeiro L1-Humanités