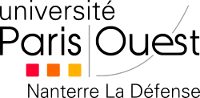déc.
20
Soumis par Hélène Courtel le jeu, 12/20/2012 - 12:26
Depuis quelques jours, un petit être voyage dans mon estomac. Dire « quelques jours », c’est peu et imprécis : cela fait deux cent vingt et un jours qu’il se promène çà et là. Il ne cesse de grossir et s’allonge encore davantage. Au début, il était minuscule, pratiquement anodin. Mais le temps passe et le petit ver se nourrit du sang qui coule en moi, aspire mes réserves et me vide progressivement, presque intégralement. Je le sens parcourir mon corps, aux instants les plus critiques, alors je m’interroge : « Est-il vert ? ». Certains jours il se cache et une impression fallacieuse s’installe : « Il a disparu ». Un inconnu pourrait bien, pour mon plus grand bonheur, l’emprisonner dans un verre. Mais il n’est pas tout seul, il y a aussi cette pierre : le petit ver et elle partagent le même cocon.
Je ne vous ai pas encore parlé de Pierre.
Toujours présente au creux du ventre, je la traîne chaque matin. Sa pesanteur rend le quotidien rude, long, et chaque minute plus incertaine. C’est tellement pesant, ces corps inconnus dans mon corps. Et cela laisse un goût âcre dans la bouche ; connaissez-vous ce goût ? Quand le foie produit à l’excès un liquide froid et sec, l’Angoisse plante son drapeau noir et la fadeur des jours mélancoliques s’impose. Ce qu’il faudrait, pour remédier à ces maux, et effacer tous les mots de cette page, – car une fois l’angoisse dissimulée, le corps libéré, ils ne s’écrivent plus sur la page d’un flot si spontané et nécessaire – c’est un oiseau libérateur : ces êtres-là sont beaux, majestueux, et ils ont l’avantage d’avoir des ailes. Je le vois, l’oiseau aux plumes noires ; il s’envole, ma pierre au creux des pattes et le petit ver au bec. Cette vision irradie tout mon être et calme un instant, le temps de quatre ou cinq inspirations sereines, la croissance du petit ver, la lourdeur de la pierre.
— « T’as un chat dans la gorge ? » lui demande-t-il brusquement.
Elle reste muette.
S’il savait apprivoiser son regard apeuré, il ne l’interrogerait pas : il sait bien que c’est le ver qui continue de la rendre sombre et gangrène peu à peu son âme et que la pierre est bien trop lourde pour un être aussi frêle. Mais il continue à ignorer la situation et à voiler la réalité. Comme prévu, le conducteur décide d’abandonner tout espoir de conversation sans approfondir son interrogatoire. Il appuie nerveusement et en poussant un long soupir de découragement sur le bouton de la radio. Une voix féminine s’invite alors dans la vieille Fiat 500 et rompt le silence lourd et persistant : « Une vache tente de se suicider sur l’E411 », déclare t-elle sans sourciller. La suite de son discours apparaît, au ton de sa voix, tout aussi banale : « j’apprends à l’instant qu’un conducteur fantôme circule à proximité de Mouscron, soyez prudent ».
Ils se dirigent vers Bruxelles, il est vingt heures quarante-deux minutes, le ciel est noir et les bandes blanches défilent sur le bitume : la vitesse de la voiture donne l’impression que le temps s’accélère. Les arbres se succèdent à une allure folle tandis qu’à certains moments le chemin est dévié et se révèle cahoteux à cause des dégradations sur la voie. Leurs têtes dodelinantes donnent alors un rythme, malgré eux, au fameux tube de David Bowie. Mais elle n’entend pas, elle songe à tout autre chose. Comment de telles absurdités peuvent-elles être prononcées avec tant de naturel ? Une vache, cela ne peut pas avoir envie de se suicider… Ça lui paraît aussi idiot que de croire qu’un éléphant pourrait sauter. De même, l’expression « un conducteur fantôme » n’a aucun sens. Il faudrait envisager qu’une voiture se déplace seule, sans cerveau à bord. Et pourquoi cette femme utilise-t-elle ce mot, « fantôme » ? En a-t-elle déjà vu? Ça m’étonnerait.
Un coup d’accélérateur la surprend. Marie réfléchit toujours beaucoup et à propos de tout, cela ne date pas d’aujourd’hui, c’est son caractère : cela fait plus de trente ans que cela dure. En observant son attitude et sa manière d’être, je me dis que les pierres ne s’installent pas chez n’importe qui, cela doit provenir d’un tempérament particulièrement anxieux. Elle répondrait à cela, en évitant soigneusement de faire allusion au lourd secret qu’elle porte en elle, que les pierres n’ont pas de conscience, pas de réflexion et que c’est une malédiction, un coup du sort. Moi, je lui rétorquerais, si seulement elle pouvait m’entendre, qu’il faut se montrer sensible à l’art des métaphores…
Le conducteur lui demande si elle veut faire une pause, un bref mouvement de tête mime son approbation. Il arrête la voiture d’un geste brutal et la prévient qu’il reste là, sur le parking, c’est fatigant de conduire seul : une sieste se révèle indispensable. Elle quitte l’auto, heureuse de pouvoir sentir la fraîcheur du vent et de se retrouver enfin seule. Elle arrive dans un lieu empli de monde : déjà des vertiges engourdissent son corps, la lumière artificielle l’éblouit, le brouhaha irrite ses oreilles. Elle décide tout de même de s’installer et consulte la carte des boissons. Les lettres forment une danse en accordéon face à elle : elle fait un effort pour essayer de les assembler. Mais elles volent en éclat, impossible de les déchiffrer. Tout le monde paraît pourtant serein, autour d’elle, pense-t-elle. Un couple est attablé à proximité, l’homme et la femme lisent attentivement cette même carte ; aucune inquiétude ne se détecte sur leurs visages : la ritournelle des lettres ne les trouble pas, s’inquiète-t-elle. Elle décide de quitter le lieu. La voiture est plus sécurisante finalement : espace clos sans agitation ni perturbations extérieures. Elle le retrouve, allongé sur le siège, profondément endormi.
L’entrée se fait par un chemin sinueux, il faut poser le pied sur chaque caillou pointu et piquant, incrusté dans la pierre. La pente est rude, les marches hautes, quarante degrés à l’ombre. La soif se fait déjà sentir tandis que la sueur baigne le corps de l’homme ; il nage dans ce liquide salé, peu odorant vu son alimentation qui se réduit ces temps-ci au minimum vital. Après une heure de marche, il aperçoit les montagnes. Il en a tant rêvé qu’il reste là, immobile et contemplatif. Malgré le soleil, une brume épaisse l’empêche de discerner parfaitement le contour de ces pics cernés d’un blanc pur. Il continue sa marche et entrevoit au loin le premier édifice. Le palais est orné de portes ayant la forme d’un fer à cheval tandis que les colonnes de stuc, d’un blanc éclatant sont gravées d’inscriptions. Chaque pièce est habitée par une pureté merveilleuse. Un magnifique édifice couleur ocre se dresse dans la salle centrale ; face à lui un bassin entouré de lions en marbre apparaît. La précision architecturale le fascine et occupe tout son esprit ; l’eau du bassin rafraîchit la chaude atmosphère. Ici tout est « luxe, calme et volupté », les clapotis jouent une douce musique. A l’extérieur, une pléthore de fleurs multicolores et le jasmin odorant embaument les jardins. De l’intérieur, ces jardins se dessinent à travers l’encadrement admirable des fenêtres : le contour ressemble à de la dentelle soyeuse. Il est accompagné de son ami de toujours, P., et entend sa voix rauque et bienveillante remarquer : « cette dentelle est comme le cadre d’une photo ; nous pouvons préserver cette image à jamais, en la fixant sur la pellicule de notre mémoire ». Sa voix poétique et sereine s’estompe. Il est réveillé par un tâtonnement brutal sur l’épaule. Retour à la réalité. Il est sur un parking, il fait nuit noire désormais. Les yeux de Marie sont bleus, mais son regard est aussi noir que la nuit et ils lui ordonnent « démarre ». Il met sa ceinture et accélère. Après quelques instants de silence, il se décide enfin à laisser sortir de sa bouche quelques mots. Comment Marie les interprétera-t-elle cette fois ? Comme des perles ou comme des crapauds ? La feront-ils réagir ou au moins rompront-ils ce pesant silence? Il hésite et se contente de murmurer prudemment : « Tu sais Marie, je viens de rêver de notre voyage à Grenade, les images étaient nettes et précises. Je ne pensais pas m’en souvenir aussi bien. Cela fait quand même quatre ans, quatre ans ». Il pense combien les choses ont changé depuis ce moment-là et n’ose en ajouter davantage ni parler de Pierre, évidemment. Il change de sujet. De toute façon cela ne suscite chez Marie aucune réaction ni réplique. Déjà, elle ne l’écoute plus. Hugo poursuit son monologue.
Je m’appelle Hugo Martinez, le jour de ma naissance, le soleil était radieux ; c’était le début de l’automne. Ma mère, Ingrid Martinez, insiste toujours sur le détail bien futile de cette météo splendide quand elle se remémore ce jour-là ; c’était un certain jeudi 25 septembre 1979. Mon enfance fut des plus heureuses ; un foyer chaleureux, des parents aimants : le moment de la vie le plus doux où les tracas amoureux, professionnels et financiers n’existent pas. Durant cette période bénie, les loisirs prenaient la part la plus importante de mon quotidien : balançoire, marelle, pierre-papier-ciseau, balle au prisonnier, roi du silence, etc. L’entrée au collège jugula soudainement cette candeur, elle la détruisit comme un cube lancé sur un château minutieusement construit : l’apparence et les marques vestimentaires prirent soudain leur importance, la compétition entre camarades, les défis, les filles, les fêtes, les peines et déceptions, la flânerie et les questions insolubles envahirent l’être et le quotidien. Mais là encore, lecteur indulgent, rien à te signaler d’original ni d’extraordinaire concernant cette époque d’égarement utile à la métamorphose et au façonnement d’un être en devenir. Cette chronologie succincte et quelque peu artificielle me permet de t’amener, de te guider, vers ce qui m’intéresse vraiment : le moment où ma vie a véritablement débuté. Tout a commencé, donc, le jour de mon entrée à la faculté Stendhal de Grenoble, loin de la capitale et du giron familial. Pour la première fois, il ne s’agissait plus de se laisser guider dans un sillon scolaire déjà tracé : il fallait choisir. Cette liberté soudaine se révèle plutôt délicate quand on aime aussi bien les sciences que la littérature, l’anglais que le cinéma : tout et rien à la fois. J’ai finalement opté, avec désinvolture, pour une « licence d’art et culture ». Ce que je ne savais pas, en empruntant cette voie, c’est que je n’avais choisi ni l’art ni la culture ; j’avais choisi Pierre et élu déjà Marie.
Les images les plus marquantes de cette période d’insouciance sont les vertigineux amphis, l’attitude déconcertante et le grain de folie de certains professeurs peu académiques, les soirées étudiantes au Latino. Et, surtout, il faut signaler les lieux de toutes les découvertes : le Kinociné où les séances étaient programmées chaque soir à vingt et une heure ainsi que le mythique Café Flore où nous refaisions le monde selon nos idéaux jusqu’au petit matin – débats politiques, artistiques, moraux.
J’avais rencontré Pierre deux semaines après le début de la rentrée universitaire, lors de la soirée d’ouverture du fameux Kinociné, la diffusion des Ailes du désir de Wim Wenders avait lieu ce jour-là. Je m’endormais face à ce noir et blanc quelque peu soporifique tandis que les yeux de Pierre, qui était assis à côté de moi, étaient écarquillés et attentifs, ils brillaient de plaisir. Son attitude me fascina, mes yeux étaient hypnotisés non par le film mais par lui. Après la séance, je ne pus résister à l’envie de lui adresser la parole. Il m’expliqua l’intérêt du film durant plus de deux heures avec une exaltation déconcertante. Depuis ce jour, nous ne nous sommes plus quittés. Son goût pour la photographie et le cinéma se décelait au premier coup d’œil lorsqu’il évoquait avec emportement Nadar, Cartier-Bresson, Godard, Steichen, Rohmer, Guibert ; ses mots me captivaient et j’aurais voulu que cette voix m’accompagne jusqu’au dernier souffle. A bout de souffle, titre de son film favori et du mien également, grâce à lui. C’est cette passion artistique et la manière d’en parler, je crois, qui m’ont séduit dès la première rencontre. Et je retrouvais, à l’époque, la même fascination lorsque j’entendais Marie parler de sa passion pour la littérature : Montaigne, Proust, Flaubert, Camus, Sarraute… Cette attitude-là devait être dans les gènes, le sang, l’ADN.
Marie rencontra Hugo lors d’une soirée organisée, à la maison, par Pierre. Elle ne prêta pas grande attention à ce jeune homme dégingandé, l’allure plutôt sèche et le regard timide. Seules ses boucles blondes qui lui donnaient un air angélique, attirèrent un instant son attention. Elle ne s’attarda pas car les amis de son frère sont toujours un peu spéciaux. Hugo, au contraire, avait tout de suite remarqué cette fille extravertie qui avait la même détermination, la même flamme dans les yeux que Pierre. Quelques mois plus tard Pierre, Hugo et Marie devinrent inséparables.
Après sept heures de route ininterrompue, les oiseaux se mettent à siffloter, la lune et les étoiles se voilent et la nuit s’éclaircit. Des couleurs rosâtre et orangée se forment en éclairs dans le ciel. La Fiat 500 s’approche d’une maison de campagne en pierre noire ; sur la porte un écriteau bleu foncé aux lettres blanches indique « Auberge des Lilas ». Hugo gare la voiture. Madame Lefèbvre est assise à la fenêtre, elle scrute de ses petits yeux noirs-curieux les deux jeunes gens qui sortent du coffre une grosse valise verte. Ce n’est pas l’homme au long paletot noir et aux cheveux bouclés blond foncé qui l’interpelle, c’est cette femme. Elle a rarement vu un être à l’allure aussi fantomatique : le dos courbé, le visage tellement pâle qu’il semble transparent, les larges cernes sous de grands yeux d’un bleu pourtant intense dessinent cette mine triste. Elle marche d’un pas lent, tel un funambule novice craignant à chaque pas une chute vertigineuse. D’ailleurs Madame Lefèbvre ne se trompe pas : Marie est si désorientée, tourmentée et courbaturée par les heures passées dans la voiture qu’elle est obligée de suivre Hugo à la trace. Elle ne sait pas où elle va et se contente de suivre, cela lui demande déjà beaucoup d’efforts. Madame Lefèbvre, intriguée, se précipite à la porte de l’auberge pour accueillir ses nouveaux convives : « Bonjour, bienvenue à l’auberge des Lilas », déclame-t-elle d’un air enjoué. Hugo se contente de balbutier un bonjour de courtoisie tandis que Marie ne répond pas. Elle n’a pas entendu, ou pour être plus précis, seul un fin bruit est venu secouer le chaos qui règne en elle depuis le 7 décembre dernier. Depuis ce jour, elle est engloutie dans une matière cotonneuse qui amortit les sons, sa vue est trouble et sa voix altérée. Elle est dans sa bulle ou plutôt son scaphandre. Hugo discute avec Madame Lefèbvre qui lui tend finalement une clé et l’invite à se joindre aux autres résidents de la vaste maison. Hugo et Marie déposent la valise dans la chambre et se dirigent ensuite vers la pièce commune où un groupe de huit personnes est déjà réuni autour d’une grande table en bois. Ils boivent du café et dégustent quelques croissants croustillants. Marie focalise son regard sur la pièce maîtresse de la salle : une reproduction d’œuvre d’art trône au-dessus de la cheminée. Les couleurs jaune et orange agressent son œil, elles sont comme un électrochoc qui réaniment son corps et remettent ses sens altérés en mouvement. En découvrant ce squelette ondulant et flottant, elle a l’étrange impression de découvrir son reflet dans le miroir. Cela devrait susciter beaucoup d’effroi de s’identifier à la silhouette du Cri d’Edvard Munch, et pourtant chez Marie cela produit le sentiment inverse : « d’autres avant moi ont ressenti une telle souffrance », pense-t-elle. Elle reste immobile face au tableau, Hugo la prend par la main sans un mot, il l’aide à s’installer sur la chaise. Elle frissonne d’angoisse dans ce lieu pourtant douillet et confortable. Hugo et Marie sont l’un en face de l’autre, ensemble, dans une salle emplie de monde et de convivialité ; cependant, à nouveau c’est comme s’ils étaient seuls face à eux-mêmes. Hugo n’ose regarder Marie, la posture de conducteur est plus simple, il faut regarder la route ; face à face, tout est différent, il doit se confronter au réel et à la métamorphose de cette tête. Marie ne regarde pas Hugo, le tableau occupe tout son esprit. Ce nouvel ami, ce nouvel allié devient tel un alter ego, double d’elle-même tandis que dans ce triste monde, chaque être est devenu invisible à son regard vitreux. Toutes les voix babillent et s’agitent autour d’Hugo et Marie tandis qu’ils sont immobiles, telles deux statues, dans deux mondes opposés. Hugo se laisse bercer par les conversations des autres convives : les lèvres se meuvent, il les contemple sans essayer de comprendre. Tout cela a la saveur d’une langue étrangère et cela le repose ; il se laisse bercer sans réfléchir. Cela le distrait et l’empêche surtout de regarder Marie qui a désormais l’allure d’une poupée de cire : son regard est fixé sur le tableau effrayant. Soudain, elle pousse un cri – le premier qui sort de sa bouche depuis des semaines. Elle se lève et s’approche du tableau. Elle s’écrie : « il est là, il est revenu, il est ici ». Tout le monde la regarde en la dévisageant. Hugo lui demande : « qui est là chérie ? ». Elle se contente de répondre, d’un air horrifié : « c’est Pierre ». Elle s’évanouit.
Il se sont quittés il y a cinq jours sans un revoir ni un dernier baiser. De toute façon il lui a toujours dit qu’il était comme Manuela dans Todo sobre mi madre : il déteste les adieux. Alors, elle est partie comme une voleuse, sans rien dire, au petit matin. Depuis elle ne l’a pas oublié, elle ne pense même qu’à lui et leurs retrouvailles. C’est étrange, d’habitude les séparations ne sont jamais déchirantes pour elle : elle souhaite avant tout préserver sa liberté, son indépendance et même sa solitude. A l’évocation de la lumineuse image des amours retrouvés, du moment où ils se reverront, un frisson la secoue : si tout était différent, transformé, envolé… Et pourtant elle ne pourrait plus vivre sans lui, reprendre sa vie d’avant. Ils jouent un jeu dangereux, elle le sait bien : ne pas s’attacher, savourer, s’en aller. Elle ferme les yeux et libère quelques gouttes salées qui coulent sur ses joues rosées ; comment calmer cette peur du vide, cette peur du rien ? Elle ferme les yeux, un instant encore, pour que la remémoration soit plus longue et les images qui se succèdent plus lentes. Ses doux cheveux, leurs étreintes, ses caresses, leurs baisers. Elle voudrait retrouver leurs corps serrés, enlacés, cette sensation de puissance et d’invincibilité, leur force. Cette image est belle, elle la hante et la glace simultanément. Elle ne sait plus où elle en est, alors elle préfère fuir. Son métier de reporter est parfait pour se sauver dès que la situation n’est plus supportable : son « métier-voyage », comme elle l’appelle souvent, lui permet de s’éclipser, de ne pas s’attacher, et de garder une distance avec les êtres et les choses.
Virginie prend le train de vingt heures quinze à destination de Paris-Nord. Son avion pour Glasgow s’envole le lendemain ; elle va enquêter sur les légendes à propos de « la pierre du destin » pour un magazine.
« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, votre attention s’il vous plaît : le train numéro 7066 à destination de Paris Nord aura un retard d’une heure trente. Un corps est en effet sur la voie. Je répète, notre train sera immobile pendant une heure trente, merci de nous excuser pour la gêne occasionnée ». Un brouhaha incommensurable l’entoure, la plupart des passagers se précipitent sur leur mobile : « Allô, ce n’est pas la peine de nous attendre, ce soir pour le repas, le train a du retard, comme d’habitude » ; un homme robuste aux cheveux gris et costume noir grogne nerveusement, « Ah la SNCF c’est incroyable ! » ; tandis que quantité de voyageurs s’agitent. Ils pensent tous à leurs impératifs du moment. Virginie, elle-même, se surprend à être contrariée : elle avait rendez-vous avec Ju pour dîner. Cela fait quatre mois qu’elle n’a pas vu sa meilleure amie et elle va pourtant être en retard.
Soudain elle pense à cet homme. Elle se souvient du mort. Comment l’appeler : la victime ? le martyr ? le coupable ? Pas loin d’ici, un être est inanimé, étendu sur la voie. Elle songe à son corps, au sang et surtout au moment où il a accompli le geste fatal. Que s’est-il donc passé dans sa vie, dans son esprit, pour qu’il décide de sauter ? Pourquoi n’a-t-il pas trouvé un visage ou une raison qui le retienne ? Elle déroule la série de scénari plus banals les uns que les autres : sa femme l’a quitté ce matin, un spécialiste lui a peut-être annoncé une maladie grave, une personne de sa famille est morte et le deuil est impossible. Cet homme est peut-être fou et il s’est enfui de l’hôpital psychiatrique ? Ou alors, autre possibilité : il a commis un crime atroce et la culpabilité l’a tellement rongé qu’il s’est tué… Toutes les hypothèses sont possibles mais elles resteront sans réponse. Virginie peut spéculer encore longtemps sur la tragique destinée de cet homme, mort durant une nuit noire.
Lecteur bienveillant et exigeant, je t’invite désormais à choisir la fin que tu préfères donner à cette nouvelle. L’épilogue le plus sinistre est malheureusement, tu t’en doutes, le plus cohérent et vraisemblable vu le reste de l’intrigue : l’homme mort durant le voyage de Virginie s’appelle Pierre. Il s’est jeté sur la voie le 7 décembre 2006. Depuis ce jour, sa sœur prénommée Marie a perdu sa voix, ses repères, ses sensations : toute sa vie a été anéantie en un geste et trois destins se sont simultanément brisés. Trois, et non deux, car il ne faut pas oublier Hugo, le fiancé de Marie, et le meilleur ami de Pierre. Hugo a décidé qu’il devait agir et réagir sinon Marie aurait suivi la même voie que son frère d’ici peu. Il a donc pris la voiture et les a emmenés loin de Paris, en Espagne, revoir les montagnes de la Sierra Nevada…
Face au deuil, Hugo et Marie ont deux attitudes opposées. L’esprit de Marie s’est refermé sur lui-même : elle saisit des bribes du monde extérieur – une chose entendue, vue, sentie – et focalise tout son esprit dessus. Cette attitude incontrôlée, lui permet pour l’instant, de se protéger et de ne pas penser consciemment au drame. Seuls certains flashs de sa « vie d’avant » lui reviennent parfois. Mais elle ne sait plus à quoi ces images correspondent : elles surgissent de manière floue et incohérente. Son cerveau ne parvient plus à les ranger ni à les lier. Cette ratiocination est bénéfique, pendant un temps, selon le Professeur Salinger. Le problème, chez cette patiente, c’est que cela dure : cela fait deux cent vingt et un jours que le drame a eu lieu, et depuis cette date, Marie est dépossédée de son être.
A l’inverse Hugo a pleinement conscience de l’atroce réalité. Comprenez-bien : il fait comme si Pierre était encore là. Il parle et rêve de lui, sa figure le hante. Mais il fait comme si la nuit du 7 décembre n’avait jamais existée. Il concentre ses souhaits, ses efforts et sa volonté sur le rétablissement de Marie. Il voudrait reconnecter leurs êtres, leurs cerveaux et qu’elle revienne dans le monde des vivants. Ces deux attitudes apparemment opposées se rejoignent : aucun de ces deux êtres ne peut accepter et se confronter à l’insoutenable réalité. En effet, il n’ont pas soupçonné un instant, le désespoir d’Hugo. Ce dernier geste de l’artiste demeure inexplicable.
La fin la plus heureuse serait : Marie se réveille brutalement, encore un mauvais cauchemar. Elle observe Hugo, allongé à côté d’elle, sa respiration est lente : il dort sereinement. Les sombres nuits aux satanés cauchemars sont récurrentes ce mois-ci. Les personnages sont bien connus : son mari Hugo, son frère Pierre et Virginie sa meilleure amie. Pourtant ils jouent un rôle chaque nuit plus angoissant. Le même décor revient sans cesse : une nuit noire. Un motif similaire aussi : une atmosphère angoissante, un destin brisé. A ce moment précis, elle revoit deux images effrayantes du cauchemar qui vient de l’éveiller en sursaut : le corps de Pierre étendu sur la voie et sa propre silhouette à l’allure fantomatique. Apeurée et troublée, elle téléphone à Pierre. Il est six heures, l’homme d’affaires est déjà en route pour le bureau comme tous les matins, il décroche son téléphone portable : tout va bien. Après cette brève et rassurante conversation, Marie plonge de nouveau dans les bas de Morphée… Cette fois son rêve sera plus serein. Le cycle infernal semble rompu.
Je te propose, lecteur avide, une dernière version, et si elle ne te convient pas cette fois, je te laisse libre d’imaginer… Virginie est journaliste, elle tente d’écrire une brève nouvelle pour passer le temps dans le train qui la conduit à Paris. La page blanche se remplit progressivement de caractères rouges juxtaposés compulsivement, elle s’inspire pour écrire de deux faits divers lus dans Libération : un homme s’est jeté sur une voie de chemin de fer et une femme a perdu sa voix. Elle souhaite mêler à la fiction quelques éléments autobiographiques disparates et jouer avec les mots, les maux et les homonymes : voix/voie, vert/vers/ver, Pierre/pierre etc. Mais sa plume roule sur le papier sans jamais parvenir à se satisfaire. Telle une préparation culinaire, « cela ne prend pas », elle bat les œufs mais la préparation demeure à l’état liquide. Alors elle cesse finalement d’écrire : son roman fantasmé reste une banale nouvelle…